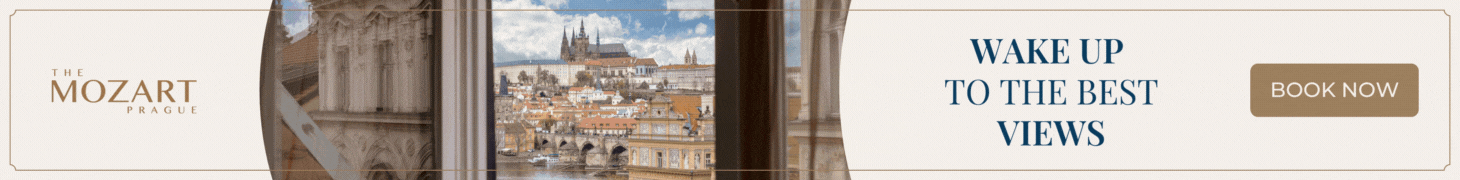Dix ans après la dernière représentation de l'ouvrage en ses lieux, l’Opéra de Monte-Carlo a offert à son public une performance particulièrement soignée de La Bohème de Puccini, mise en scène par Jean-Louis Grinda. Bien connu des spectateurs, cet opéra a su mobiliser une audience large et attentive. Une aubaine pour les mélomanes, car, comme le disait l’éminent Stravinsky : « lorsqu’on l’écoute, la musique de Puccini est à chaque fois plus belle que la fois précédente ».
Quinze heures : la rumeur des conversations latentes laisse place à un silence quasi religieux. Au lever de rideau, on découvre un orchestre raffiné, appliqué dans la réalisation d’un exploit de taille sous la direction de Daniele Callegari : réussir à faire entendre tous les instruments sur un même accord, le tout en un résultat à peine audible. Toutefois, ce morceau de bravoure n’est qu’un avant-goût des véhéments changements d’intensité et de tempos qui caractérisent le style du compositeur tout au long de l’œuvre.
Le premier tableau dévoile en Rodolfo Andeka Gorrotxategi, ténor lyrique dont la particularité émane d’un rubato généreux, placé sur les mots-clés du livret. À ses côtés, l’intense Marcello de Davide Luciano brille par son italien fluide et son timbre puissant. Les dialogues en musique menés par les deux hommes sont ponctués par la voix franche et énergique du baryton Boris Pinkhassovitch (Schaunard). Parmi la joyeuse cohue menée par le groupe parisien, apparaît Mimi chantée par Irina Lungu, au timbre discret et aux gestes retenus. Progressivement, les voix s’affirment et les deux amants chantent rimes et hymnes d’amour de manière enflammée.
Les décors épurés, spacieux et lumineux (Rudy Sabounghi) s’éloignent quelque peu du contexte miséreux dans lequel évoluent les personnages : l’atelier parisien en devient presque coquet avec son fauteuil confortable et sa magnifique verrière. Il en va de même pour les costumes (David Belugou) : la sensation de froid, pourtant fil rouge de l’opéra, passe au second plan lorsqu’on aperçoit les acteurs en tenue légère, chemise fine, robe courte et frêles souliers.
Le deuxième tableau, plus fantasque et opulent, contraste face à la sobriété de la mise en scène de la section précédente. Exit l’appartement mansardé dont la verrière laisse apercevoir les toits de Paris et place à la féérie colorée d’une kermesse improvisée. Les mouvements de foule, l’abondance de personnages et les costumes chatoyants apportent un formidable souffle de vie à la scène. Cet acte récréatif marque également la rencontre avec la voluptueuse Musetta, se dévouant corps et âme à l’interprétation d’un numéro de charme agile. La voix brillante et ronde de Mariam Battistelli semble parfaitement en écho avec l’attitude désinvolte du personnage.
Nombreux sont les passages où chants et affects se superposent : Rodolfo et Mimi (mais aussi Marcello et Musetta) interprètent simultanément amour serein et jalousie maladive. Dans ces passages, tout comme dans l’ensemble de l’œuvre, les deux personnages ressortent particulièrement, Gorrotxategi et Lungu paraissant bien plus à leur aise, autant vocalement que dans leur jeu d’acteur. En effet, tous deux possèdent une voix de poitrine bien timbrée, bien adaptée pour traverser l’orchestre et remplir l’espace scénique. Les autres rôles peinent parfois à convaincre, peut-être pas avantagés par les positions courbées souvent adoptées, qui compliquent la bonne émission vocale.
Le troisième tableau se distingue par l’utilisation d’effets numériques. Dans un extérieur glacial, aux habitations moroses, se tient un large portail recouvert de neige digitale, rendue possible par l’utilisation de projecteurs. Ces dispositifs seront de plus en plus présents au fil de la pièce : une vidéo montrant un paysage parisien – dépeint par une allée de platanes, qui se métamorphose au gré des saisons – viendra clôturer la section. Si cet interlude se montre un peu longuet, l’emploi de la technologie permet indéniablement de rendre la scène plus réaliste.
La fin du spectacle se démarque par un jeu de comédiens poignant et naturel, loin des attitudes stéréotypées que l’on a pu rencontrer précédemment. L’association des voix et de l’orchestre sera finalement parvenue à exhausser le souhait de Puccini, qui confiait : « je veux que mon public ne puisse retenir ses larmes : l’opéra, c’est ça ! »