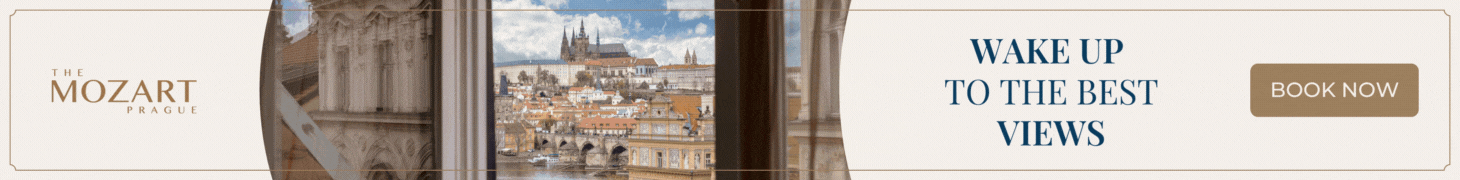Que Netia Jones juge le pardon de la Comtesse à son monstre de mari très peu crédible, c’est son droit : quelle femme, dans « la vraie vie », passerait outre cette succession ininterrompue d’insultes à son égard ? La dernière scène de son spectacle nous montre donc la Comtesse rendant son alliance au Comte et le quittant d’un pas décidé, aucune réconciliation ne semblant possible. Soit. Mais le hiatus entre ce que ce que la scène donne à voir, ce que le texte donne à lire, ce que la partition donne à entendre est vraiment trop important pour légitimer cette lecture. La scène du pardon, l’une des plus bouleversantes de tout l’œuvre mozartien, signe tout à la fois une prise de conscience tardive par le Comte du caractère abject de son attitude, une volonté réelle de s'amender, tout en consacrant également le triomphe de la Comtesse : en pardonnant, Rosina se place très au-dessus de la mesquinerie, de l’étroitesse d’esprit des hommes qui n'ont eu de cesse, au fil de l’œuvre, de susciter querelles, vengeances, agressions de toutes sortes. Quoi qu’il en soit, le caractère particulièrement jubilatoire des paroles (« Allumez les feux de joie, allons tous festoyer ! ») et de la musique chantées par tous les personnages (y compris le Comte et la Comtesse) dans les dernières mesures de l’œuvre entre en parfaite contradiction avec le sombre dénouement de l’intrigue voulu par Netia Jones.
C’est peut-être le problème essentiel de cette mise en scène qui, malgré quelques vulgarités assez stupéfiantes (Chérubin se masturbant en chantant « Parlo d’amor con me »), ou quelques « idées » pour le moins incongrues (le Comte se déculottant pendant son air pour finir en caleçon) fonctionne plutôt bien, pour peu qu’on accepte d’être pour la énième fois confronté à une mise en abyme bien galvaudée : l’intrigue prend place dans un théâtre où l’on répète Les Noces de Figaro ; le Comte semble être tout à la fois l’interprète du premier rôle masculin, mais aussi le directeur du théâtre, profitant de son statut pour faire défiler dans sa loge jeunes ballerines et apprenties chanteuses…
Musicalement, c’est une belle soirée. Luca Pisaroni est, ce soir, vocalement un peu fatigué : les notes les plus aiguës du rôle de Figaro lui échappent, et ce dès le « Se vuol ballare ». Mais l’incarnation musicale et scénique du personnage est excellente et pleinement convaincante. Peter Mattei retrouve avec le Comte l’un de ses grands rôles : il y est superbe d’autorité vocale, notamment dans un « Hai già vinto la causa » inquiétant, agité, rageur à souhait. Ying Fang (Susanna) a besoin de quelque temps pour libérer pleinement toutes les ressources d’une voix qui, au premier acte, reste un peu contrainte et se trouve limitée en projection. Mais dès l’acte II, la voix prend une belle ampleur et révèle un panel de couleurs qu’on ne lui soupçonnait pas, l’interprétation culminant dans un « Deh vieni » très applaudi.
Dans le rôle de la Comtesse, la voix de Maria Bengtsson n’est pas des plus puissantes, cela se ressent un peu dans les ensembles. Mais quelle poésie dans un chant par ailleurs constamment contrôlé ! La reprise pianissimo de « Dove sono », chantée sur le souffle, est absolument superbe et semble l’expression d’une douloureuse méditation intérieure. Enfin, Lea Desandre se confirme comme l’un des meilleurs Chérubin du moment : quelle délicatesse, quels raffinements, quelle sensualité dans la ligne de chant ! S’ajoute à cela une gourmandise dans la prononciation de certains mots (le « palpitar » de « Non so più ») et surtout une aisance scénique qui en font un adolescent parfaitement convaincant. Le plateau est complété par une solide équipe de comprimarii, au sein desquels se distinguent particulièrement la Marcellina de Dorothea Röschmann, et surtout la Barbarina stylée et raffinée de Kseniia Proshina, l’une des recrues les plus prometteuses de l’Académie de l’Opéra.
Après Turandot, voici donc la seconde et dernière production lyrique de Gustavo Dudamel à l’Opéra de Paris cette saison : deux productions seulement, mais qui permettent de rendre parfaitement compte des qualités du chef et de sa versatilité, Dudamel faisant face aux rutilances de l’orchestre puccinien et aux raffinements de l’écriture mozartienne avec le même talent et la même efficacité. Sa lecture nerveuse, incisive (quelle vivacité des cordes dans l’ouverture, ou dans l’air du Comte auquel elles apportent une sorte de commentaire ironique et grinçant !) sait faire place à la plus tendre poésie pour les parenthèses apaisées que constituent le duettino de Susanna et de la Comtesse, le « Deh, vieni » ou encore le « Contessa, perdono » final… Mais on aura surtout apprécié le talent de Dudamel à lier les pages entre elles de façon à établir une belle continuité dans le discours musical sans jamais donner l’impression de juxtaposer les numéros, telle page ne surgissant pas après telle autre, mais à cause de ce qui précède : un vrai chef de théâtre !