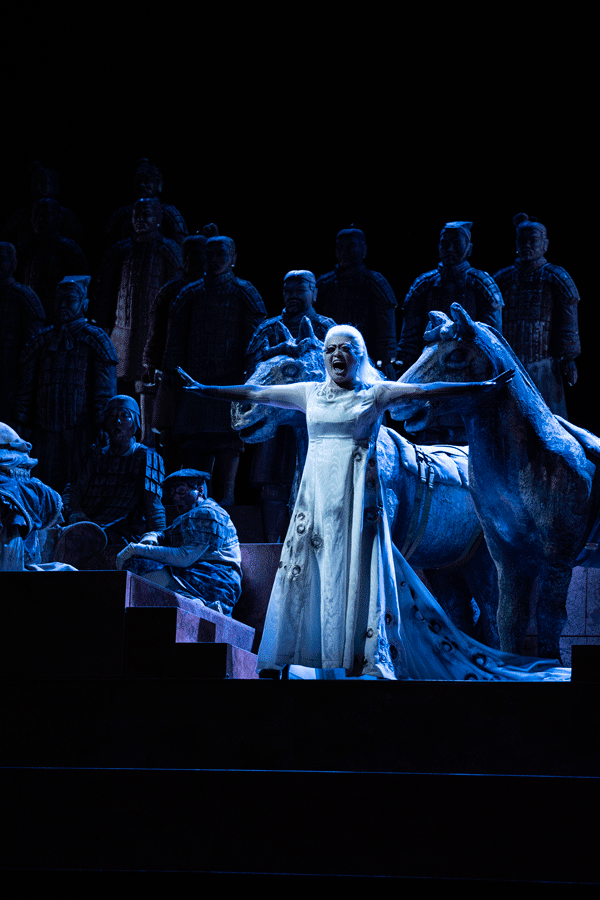
Le metteur en scène autrichien Valentin Schwarz, 30 ans cette année compte à son actif une dizaine de mises en scènes, et à 28 ans, il est vainqueur du prestigieux concours international de mise en scène « Ring Award Graz » avec son décorateur Andrea Cozzi milanais installé à Vienne. À peine trentenaire, il a reçu la commande du Ring 2020 de Bayreuth, dans des délais très réduits. Il en a accepté le défi, rappelant un certain Chéreau à qui la proposition échoua tardivement également, à peu près au même âge (il avait 32 ans à la création en 1976, Schwarz aura 31 ans).
Mais il serait problématique de lire cette production de Turandot à l’aune de ce futur Ring, qui risquerait de brouiller les cartes.
Valentin Schwarz pose la question de la possibilité de cette histoire, née d’un conte de Gozzi, qu’il lie à la période de composition, peu après la première guerre mondiale, où le culte du héros individuel en a pris un coup, et où l’on revient au conte, comme expression de rêves d’une société complètement déchirée par la guerre. La Turandot de Busoni est de 1917, Die Frau ohne Schatten de Strauss de 1919 et la génèse de la composition du chef d’œuvre de Puccini commence à peu près en 1920 avec la première version du livret de Giuseppe Adami et Renato Simoni. Mais d’autres opéras s’appuient sur des contes à cette période, comme Le Château de Barbe Bleue (1918) ou L’amour des trois oranges de Prokofiev en 1921. Valentin Schwarz va travailler non sur la question du conte ou sur sa signification, il refuse de travailler sur le récit même, mais il va travailler en lien avec un autre élément de l’époque, déterminant, qui est la psychè, au moment où la psychanalyse commence à s’installer dans le paysage, et à un moment clé de la peinture européenne et notamment allemande avec le réalisme expressionniste d’Otto Dix ou Max Beckmann. Travail sur la psychè d’un peintre…
C’est donc de la peinture que Valentin Schwarz part, faisant de Calaf un peintre, dont la peinture est une sorte d’expression de ses fantasmes ou de ses phobies (la dernière version du Cri de Munch est de 1917). Et le décor montre un petit coin très réaliste (lit, lampe de chevet, quelques meubles) qui pourrait être sorti de La Bohème et une immense toile, avec en transparence le monde fantasmé de Turandot où le peintre va s’immerger, comme si c’était son monde noir. Timur et Liu étant des personnages transactionnels, les freins de la réalité, dans et hors le fantasme du héros.
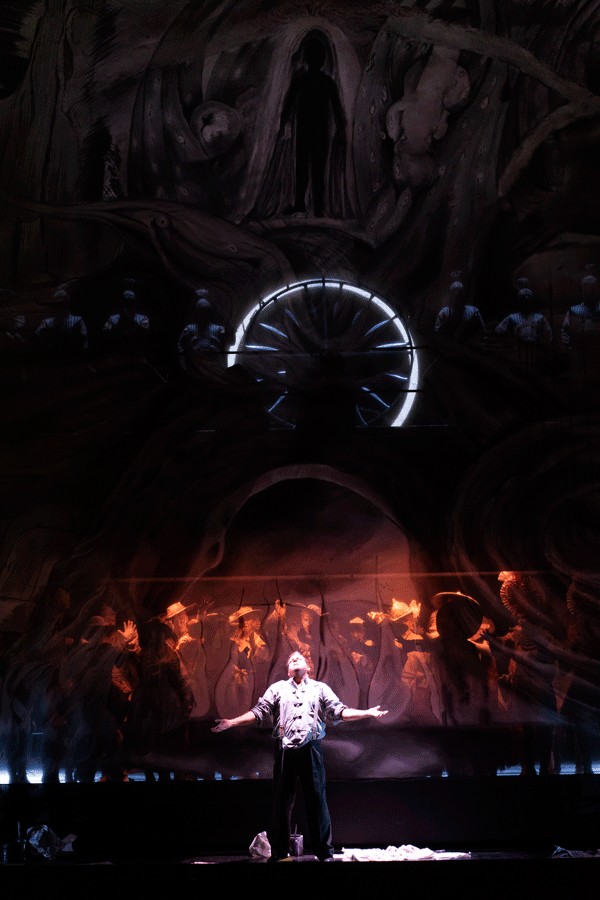
Ainsi Calaf n’est plus le sujet d’un conte, mais celui qui le fait naître, le personnage central (la thématique de la saison de Darmstadt est « Adieu au héros ») d’où va procéder toute l’histoire. Tout ainsi va sortir de la psychè de Calaf, qui va entrer dans son tableau, comme la résultante de son délire. Alors cette Chine rêvée est dépeinte par le décorateur Andrea Cozzi, le partenaire habituel de Schwarz, comme un peuple presque fossilisé sur une sorte d’escalier monumental, où émergent les figures de l’armée de terre cuite de Xi’an (costumes très réussis de Pascal Seibicke), ces 8000 statues funéraires du tombeau de l’Empereur Qin. C’est bien la question de la mort qui est au centre de l’histoire, une mort rituelle que dans le conte, Turandot organise à chaque échec d’un prince. Et que Calaf va interrompre et transformer en amour, le couple Eros/Thanatos, étant assez commun dans la littérature.
L’histoire du conte montre un Calaf sûr de lui et inconscient qui défie la princesse et qui défie la mort au prix de tout le reste. Schwarz concentre son travail sur la schizophrénie d’un personnage qui va de la même manière tout anéantir sur son passage, et notamment son monde « réel », puisque Liu est de toute façon sacrifiée dans l’affaire.
Car le chef Giuseppe Finzi et le metteur en scène ont choisi de représenter Turandot tel que l’opéra a été présenté le jour de la première par Toscanini le 25 avril 1926, s’arrêtant à la mort de Liù et ce choix déplace forcément la focale, parce que la question de l’amour de Turandot et Calaf ne se pose plus, mais bien plutôt les effets de l’attitude de Calaf. Il n’y a donc pas de résolution ni de happy end.
Le travail de Schwarz et Cozzi propose une lecture cohérente, avec de superbes images, au moment de Nessun dorma notamment, de belles images du chœur qui semble comme prisonnier dans une gangue, et aussi de belles images de Turandot, une Turandot en lunettes noires, cachant ses yeux, et en robe blanche recouvrant une combinaison de cuir noir, avec l’ambivalence du personnage voulue par Calaf dans son fantasme, sur fond de lune obsessionnelle (elle est citée dès le début dans le livret). Il y a chez Turandot quelque chose d’une domina, d’une maitresse, comme dans une relation sado-maso, d’un vampire qui vampirise Calaf (voir comme elle se jette sur lui comme pour le mordre). Superbe image aussi que l’image finale d’une Turandot qui s’éloigne au sommet de l’escalier, seule, pendant que la pluie tombe violemment sur le cadavre de Liù. Une fin sans résolution, comme suspendue, où l’on ne sait si Calaf est sorti de son monde fantasmatique parce que la mort de Liù aurait fait effet de réalité. Une fin suspendue à la scène comme dans la musique. Intéressant.
Il reste que ce travail intelligent ne va pas vraiment jusqu’au bout, notamment en ce qui concerne les relations des personnages entre eux, les gestes, les mouvements : tout reste même assez conforme aux convenances de l’opéra. Schwarz n’a pas approfondi ces relations parce que sans doute pour lui elles n’existent pas, ou qu’elles n’existent que par rapport aux fantasmes de Calaf, que les personnages ne surgissent que de sa psychè, comme s’il était le centre d’un système de planètes qui tourneraient autour de lui. Seule Liù semble avoir une existence, pas très différente de celle de l’opéra traditionnel où elle occupe la même fonction, celle d’un discret ange-gardien qui se sacrifie. L’égocentrisme d’un Calaf monomaniaque est le centre du système, mais même ce Calaf, en termes de construction du personnage, se définit presque une fois pour toutes, sans toujours que Schwarz n’en tire une vision fouillée et une vraie construction. D’où pour Calaf aussi l’impression de gestes stéréotypés de l’opéra. Seule Turandot peut-être est l’objet d’une vision plus profonde, moins lointaine que dans la tradition où elle est souvent vue comme une sorte de statue vivante. Il y a dans la composition de Soojin Moon quelque chose de plus urgent, de plus « sensible » parce qu’elle n’est pas en elle-même, mais par la construction de Calaf, elle est Calaf en quelque sorte, son émanation, et donc ses gestes sont déterminés par le personnage masculin, ils en émanent.
On sent bien la complexité de la construction, la subtilité de la pensée du metteur en scène, qu’il n’a pas réussi complètement à rendre lisible ou convaincante, notamment dans la manière de rendre Liù et dans le rapport entre réel et fantasme.
Cette Turandot a le mérite de proposer une vision qui, sans être forcément neuve d’ailleurs, – les mises en scène qui montrent les fantasmes ou les rêves d’un personnage ne sont pas rares – , marque une idée intéressante pour sortir cette histoire de sa tradition et d’éviter les écueils du pittoresque : la Chine ici n’a rien d’un tableau d'opérette coloré et clinquant à la Zeffirelli, c’est une Chine sombre, agitée, angoissante aussi, qui peut-être aussi celle de Gozzi.
Et puis Schwarz discrètement construit un paysage aussi typiquement puccinien par les allusions : Calaf est peintre comme Mario de Tosca, et il habite une mansarde (ou une pauvre chambre) comme dans La Bohème, unissant ainsi par l’image les trois plus grandes œuvres du compositeur, créant d’une certaine manière un univers en réduction, un petite système de signes pucciniens.

La réalisation musicale est très respectable et l’on doit ici souligner la qualité d’ensemble pour un théâtre d’une cité moyenne d’environ 150000 habitants, que des villes comparables en France ne sauraient défendre de la même manière… C’est aussi la grande supériorité du théâtre de répertoire qui permet d’entretenir des forces artistiques solides et d’offrir une variété de spectacles au public. Le bâtiment du théâtre est moderne, monumental au centre de la ville (son portail d’entrée est impressionnant), possède plusieurs salles, avec une saison d’opéra, de théâtre et une saison symphonique…
Ainsi faut-il saluer la direction musicale de Giuseppe Finzi, assez serrée en évitant le trop spectaculaire, en évitant aussi le clinquant, ce qui est si facile dans Turandot, avec un orchestre solide, sans scories, notamment les cuivres très clairs et solides, et l’ensemble des bois (si importants dans Turandot) très en place, mais il est aussi particulièrement juste dans l’accompagnement des parties lyriques, notamment dès le début pour le chœur perché tarda la luna, d’un grand raffinement et très éthéré, où le chœur est vraiment remarquable de légèreté et de douceur .
La salle d’environ un millier de places (en vision frontale) est suffisamment vaste pour que la musique n’écrase pas le spectateur, et le chef fait en sorte que le plateau soit entendu, notamment la Turandot de Soojin Moon, qui n’a pas ici une voix au volume spectaculaire, mais qui s'entend clairement, avec beaucoup de présence.
Même remarque sur la belle préparation du chœur, par Sören Eckhoff (qui a été chef de chœur à Munich jusqu’en juillet dernier et qui maintenant est chef de chœur à Darmstadt), plein de relief et à la diction claire, comme nous l’avons déjà souligné plus haut.
Saluons également une troupe de solistes venus de la troupe ou « Gäste » (invités) et d’abord les trois ministres Ping (Julian Orlishausen), Pang (David Lee) et Pong (Michael Pegher), très précis. Les rôles, hérités des masques de la Commedia dell’arte imposent un travail rythmique important, une parfaite adéquation à l’orchestre, et un beau travail d’ensemble. Et tout est au point et bien conduit, notamment leur grande scène du début de l’acte II, tirée au cordeau.
Altoum (Lawrence Jordan) est peut-être le seul maillon faible de l’ensemble, voix, phrasé, diction problématiques, mais le rôle reste si épisodique.
Timur en revanche (Johannes Seokhoon Moon) a une voix chaleureuse, et bien posée, il est particulièrement émouvant et tient le rôle au point qu’il remporte au rideau final un beau succès.
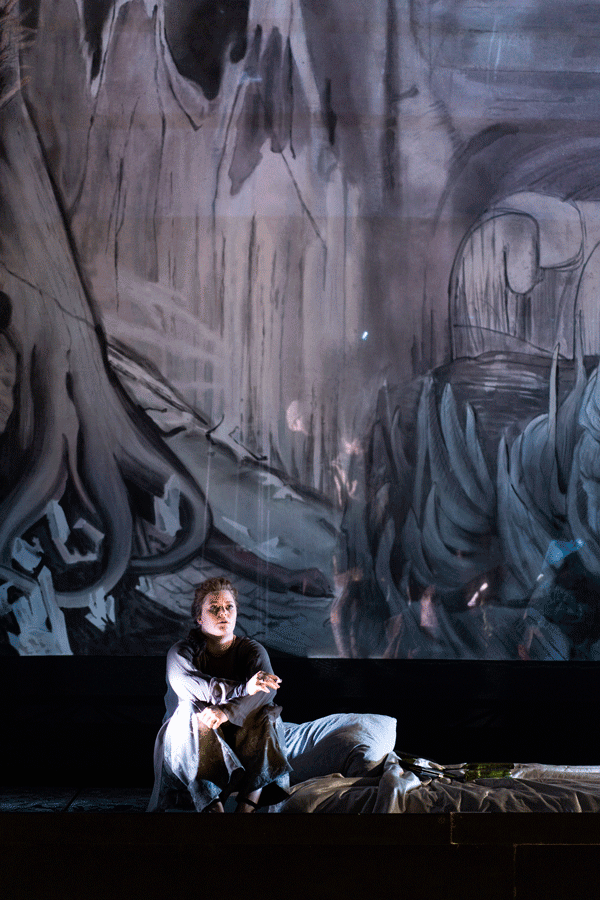
La Liù de Jana Baumeister est sans l’ombre d’un doute celle qui emporte les suffrages du public, elle triomphe et c’est mérité. La voix est contrôlée, techniquement impeccable, avec un très beau phrasé et c’est un chant vraiment incarné. C’est une des meilleures Liù entendues ces dernières années, la voix est homogène, le chant est engagé. Comme elle chante Perché un di, nella reggia, m’hai sorriso est vraiment émouvant, son Signore ascolta, et son Tu che di gel sei cinta sont bouleversants. Belle découverte que cette voix très lyrique. À suivre.
Aldo di Toro en Calaf est très attentif au phrasé, il a une voix claire qui assure le rôle, bien placée, avec des aigus bien soutenus par le souffle et puissants. Sa prestation est au total convaincante, et il a une présence scénique affirmée et engagée, c’est un bon Calaf et il répond au personnage voulu par la mise en scène, même si il n’apparaît pas totalement dirigé. Son final du premier acte avec ses Turandot lancés est impressionnant.
Soojin Moon est Turandot, une Turandot qui s'impose, émergeant des statues de l'armée de Qin, comme émergeant d'un monde mort, ou mortifère. La voix n’est pas de celles qui cassent les vitres, c’est une vraie voix de lirico spinto mais sans aller jusqu'au soprano dramatique, et ce n’est donc pas une Turandot torrentielle. Son in questa reggia passe la rampe avec honneur. Et le personnage et la voix conviennent parfaitement à la mise en scène, et à la vision de Schwarz, une Turandot qui est produite par l’esprit fragile de Calaf et qui néanmoins incarne son côté noir et ambigu. La voix n’est pas énorme, mais elle est homogène di grave à l’aigu et elle tient la partie sans faillir.
Au total une représentation vraiment convaincante musicalement, et une production solide où les idées sont intéressantes, avec des moments justes, et de très belles images, d’autres moins réussies avec un travail à raffiner du côté de la direction d’acteur et à rendre quelquefois plus lisible… Une bonne soirée au demeurant.
