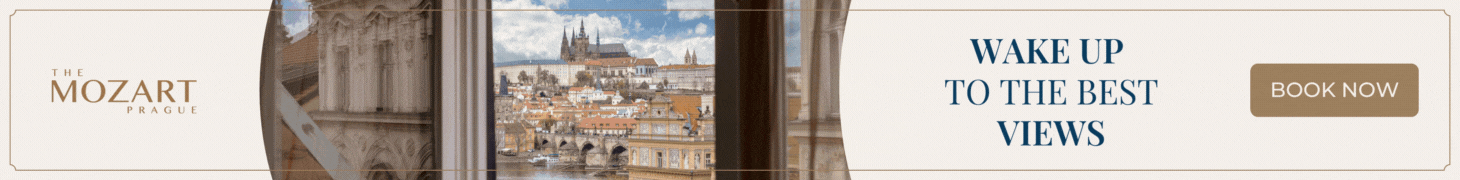Plusieurs raisons expliquent que La Khovantchina n’ait jamais atteint la renommée d’autres œuvres du répertoire russe : un arrière-plan historique peu familier aux occidentaux (le schisme qui divisa l’Église russe au XVIIe siècle et vit l’émergence des « Vieux-Croyants », soutenus par les streltsy – la garde royale –, lesquels s’opposèrent à l’avènement de Pierre-le-Grand), la relative longueur de l’œuvre, l’absence d’une figure marquante soudant entre eux les éléments quelque peu disparates du livret et donnant à l’action une ligne directrice claire… La musique, pourtant, est d’une splendeur de tous les instants, tantôt flamboyante, tantôt empreinte d’un lyrisme puissant… L’accueil enthousiaste du public au rideau final le prouve : l’Opéra de Paris a bien eu raison de proposer de nouveau cette œuvre encore trop rare sur nos scènes.
Il faut dire que toutes les conditions étaient réunies pour assurer le succès de cette reprise. Le spectacle d’Andrei Serban (mise en scène) et Richard Hudson (décors et costumes) tout d’abord : créé il y a vingt ans, il vieillit plutôt bien. Se situant à mi-chemin de l’illustration réaliste et de la vision stylisée, il oscille entre le (presque trop) traditionnel et le convaincant, le séduisant (la Place Rouge, le palais de Golitsine) et le moins réussi (ce vilain arrière-plan gris qui apparaît à partir de l’acte III) ; il exploite au mieux les possibilités offertes par le vaste de plateau de l’Opéra Bastille, tout en réussissant à préserver le caractère intime de certaines scènes, telles celles se déroulant dans les appartements de Golitsyne ou de Khovansky ; mais surtout, il laisse la musique se déployer librement, étayant le propos musical et dramatique sans le heurter ni le contredire.
Musicalement, les représentations ont été confiées à Hartmut Haenchen, lequel délivre une lecture de l’œuvre précise et soignée, presque trop pourrait-on dire : un soupçon de rugosité, de flamboyance, de souffle supplémentaire aurait sans doute permis de donner à cette fresque historique et humaine une plus juste mesure de ses vastes proportions. En l’état, la lecture proposée n’en reste pas moins convaincante – avec quelques scènes qui marquent durablement l’auditeur, telles aux deux extrêmes l’Andante tranquillo du prélude et l’obsédant finale, lugubrement martelé par le glas. L’orchestre de l’Opéra apparaît en grande forme et les chœurs sont parfaitement impliqués… à défaut d’être irréprochables : quelques aigus un peu trémulants chez les sopranos viennent en effet rompre l’homogénéité de la pâte sonore, et surtout l’on déplore plusieurs attaques manquant de précision et de netteté. Les forces musicales de l’Opéra n’en seront pas moins très chaleureusement applaudies au rideau final.
Les quinze solistes requis par l’œuvre forment une équipe soudée et globalement très homogène. Anush Hovhannisyan est une Emma au timbre certes un peu vert, et si John Daszak (Golitsyne) impressionne par la facilité de sa projection, ses aigus forte ont tendance à perdre de leur soutien et à se laisser gagner par un vibrato un peu prononcé. Mais Vasily Efimov est un Kuzka truculent et attachant et Gerhard Siegel un scribe amusant et bien en voix. Evgeny Nikitin incarne un Chaklovity noir et inquiétant à souhait – même si son aria de l'acte III requiert un legato et un lyrisme qui (ce soir du moins) ne semblent pas être le fort du baryton. On a connu des princes Andreï au format vocal plus ample que celui de Sergei Skorokhodov (ne serait-ce que sur cette même scène, où Vladimir Galouzine tenait le rôle en 2013). Sa prestation n’en demeure pas moins tout à fait satisfaisante, le ténor russe brossant un portrait convaincant de ce personnage dramatiquement assez ingrat, porté par des accents virils et autoritaires sans pour autant verser dans l’exagération ou l’emphase. Les deux rôles de basse ont très judicieusement été confiés à des chanteurs possédant des voix très différentes : Dimitry Ivashchenko (Khovansky) possède un timbre plus clair et une projection plus mordante que son confrère, deux qualités qui siéent particulièrement à ce personnage de leader, quelque peu fruste et ambitieux. La voix de Dmitry Belosselskiy (Dossifeï) est quant à elle plus profonde, plus noire, plus immédiatement impressionnante peut-être également : autant de caractéristiques très bienvenues pour cette figure de patriarche aux propos tantôt prophétiques, tantôt fanatiques et autoritaires.
Anita Rachvelishvili (Marfa), enfin, est la triomphatrice de la soirée. Elle impressionne par un registre grave d’autant plus étonnant qu’il semble émis sans que la chanteuse ait jamais besoin de forcer ou de poitriner à l’excès, mais aussi par les capacités de son chant à épouser, le plus naturellement du monde, les émotions et les styles les plus variés : de l’affrontement amoureux avec Andreï à la fameuse « Divination » de l’acte II, de la triste chanson du troisième acte évoquant son amour perdu aux accents fatalistes de la scène finale, tout est parfaitement maîtrisé et superbement vécu.
Un beau succès pour l’Opéra de Paris, d’autant que maintenir à l’affiche une œuvre aussi vaste et sollicitant autant d’artistes, en cette période de pandémie, n’a pas été de tout repos…