
Mort-née.
On peut discourir sur les raisons d’avoir réduit à 50 ou en Bavière en Suisse les jauges des théâtres, c’est une manière de les fermer sans le dire. Autant faire comme en France, où l’on ferme, sans autre forme de procès, le théâtre et le cinéma n’étant pas des « activités essentielles » (…). Pour simplifier, 50 (mais aussi 200–300) personnes assises sagement les unes distancées des autres qui ne bougent pas et ne parlent pas, qui restent masquées, n’ont rien à voir avec 50 personnes lors d’une fête de mariage. Bien sûr, comme je l’ai entendu de la bouche d’une de nos excellences « il faut empêcher les socialisations », et les socialisations au théâtre ont lieu durant les entractes (il n’y en avait pas pour Makropoulos) ou au moment de l’entrée et la sortie. L’entrée étant organisée selon un circuit balisé on ne socialise guère en entrant, et la sortie rapide et assez distanciée fait que les gens socialisent dehors (mais s’il pleut…).
Il faut en revanche reconnaître que les institutions culturelles ont déployé des trésors d’imagination et dépensé de grosses sommes pour maintenir l’activité : à Vienne ou à Salzbourg, on a testé et on teste à tour de bras pour que les représentations aient lieu « normalement ». En Italie, on a mis les spectateurs dans les loges et l’orchestre au parterre. À Zurich, on a mis l’orchestre à distance en-direct, avec un système de transmission sophistiqué qui n’a pas si mal fonctionné pour Boris Godunov, à Genève si le chef est en salle, dirigeant les chanteurs, on a enregistré l’orchestre, et le chef dirige aussi l’ingénieur du son qui gère l’enregistrement, montant ici, baissant là pour essayer de respecter les équilibres sonores voulus. Tout cela a coûté du temps et de l’argent, pour garantir au spectateur un spectacle digne même dans des conditions spéciales. Et ces efforts d’imagination (qui ont porté leurs fruits : pas de clusters dans les théâtres ou cinéma, on l’aurait su…) tombent à l’eau parce que tout ferme. Notre santé n’a pas de prix…
Ainsi donc voici le critique conduit à critiquer un spectacle non pour inciter le spectateur potentiel à aller le voir, mais pour « faire date », dans l’amertume – dans le cas de Genève – de savoir que tous les spectacles jusqu’à Noël sont annulés. Pas de Candide donc, nous resterons à cultiver notre jardin chez nous…Les deux premières années d'Aviel Cahn sont pour le moins perturbées.
Ainsi donc cette Affaire Makropoulos signée Kornél Mundruczó a eu le mérite de faire connaître à Genève non seulement un opéra qui n'y a jamais été représenté, mais aussi une nouvelle figure de la mise en scène d’opéra. Après deux spectacles en Hongrie, Mundruczó qui est cinéaste et acteur a été invité par Aviel Cahn à monter Le Château de Barbe Bleue et Le voyage d’hiver en 2014 à l’Opéra des Flandres et l’Affaire Makropoulos en 2016 récompensée en 2017 par un International Opera Award. Genève a donc le privilège d’être l’un des tout premiers opéras en Europe à présenter son travail alors qu’au théâtre il a déjà pas mal travaillé, en Allemagne notamment.
Les mises en scène de L’Affaire Makropoulos sont souvent focalisées sur la figure de la Diva, ou de la Star, que ce soit la mise en scène très traditionnelle de Elijah Mojinski au MET, ou celle extraordinaire sur le monde du cinéma hollywoodien de Warlikowski à Paris et Madrid, ou bien celle très récente de Tcherniakov à Zurich, qui explore la gloire par la téléréalité. Le personnage central est starisé, il est déjà exception, avant même son aventure trans-temporelle.

Mundrukzó prend l’histoire à revers et en fait un drame de l’individu, entre fiction et réalité, partant de la salle d’un tribunal dominée par le tableau « Justice » de Pierre Subleyras (actuellement au Musée Thomas-Henry de Cherbourg) peint au XVIIIe, envahie d’étranges motards en cuir noir et encasqués, comme on imagine des sbires de la Mafia.
Il y a quelque chose de surréaliste dans cette vision initiale, qui part donc de ce dossier tentaculaire de règlement sans fin d’une histoire d’héritage qui constitue la vie parallèle de l’héroïne à travers la longueur de son âge, une vie parallèle qui ne l'intéresse qu'indirectement, parce que les papiers en questions cachent un document essentiel pour elle.
En fait ces motards patibulaires et mafieux cherchent le fameux papier autour duquel toute la trame va se structurer, qui est la formule de l’élixir d’immortalité qu’a bu Elina Makropoulos au XVIIe. Et parmi ces motards apparaît Emilia Marty.
Dans sa mise en scène au Teatro Regio de Turin il y a une trentaine d’années, à une époque où peu de théâtres occidentaux osaient autre chose que Jenufa, Luca Ronconi avait placé l’Affaire Makropoulos dans d’immenses rayonnages de bibliothèques ou d’archives (décors de Margherita Palli) : déjà l’idée de l’accumulation de papiers, de souvenirs, de traces, de strates, était très présente, comme une sorte d’étouffoir.
Et c’est bien ce qu’est ici cette œuvre, sorte de dernier jour d’une condamnée à vivre et lasse de vivre, parce qu’avec le temps les émotions l’ont fuie, plus rien n’a de prise et la mécanique des sentiments, des passions, des hommes qui l’adulent l’ont épuisée.

L’idée que l’immortalité est un piège, que la vie ne prend sens que dans l’existence de la mort n’est évidemment pas nouvelle, mais elle prend dans la comédie de Karel Čapek une forme originale, presque débarrassée de tout aspect surréel, mais bien ancrée dans le réel, à l’égal d’une comédie dramatique. Čapek est un spectateur amusé et sarcastique du monde, un esprit libre et vif, donc dangereux, qui a recours fréquemment au fantastique, il mourra en 1938 peu avant que la Gestapo ne l’arrête pour l’envoyer dans les camps. Il y a donc dans cette œuvre aussi bien du drame que de la comédie, et c’est bien ce qui fait aussi son prix et sa singularité.
Pendant l’ouverture une longue scène en vidéo, course à l’abîme en moto à travers une route au paysage boisé qui ressemble à certains paysages de Bohème figure en quelque sorte le parcours d’Elina, course à la vie, puis course à la mort et enfin – ce qu’on va voir, course au document qui est la clef de sa vie et de sa mort.
En effet, la salle de tribunal initial qui fait face au public, visitée par un groupe de motards mafieux à la recherche d’on ne sait quoi est en fait l’épisode parallèle à la vie d’Emilia Marty (ou Ellen McGregor ou Elina Makropoulos ou Eugenia Montez etc…) depuis le début du XIXe siècle, une affaire d’héritage qui s’étire, comme pour justifier de l’existence prolongée d’Emilia.
Cette première partie assez courte explicite la situation d’Emilia, le procès Prus/Gregor, qu’elle semble parfaitement connaître à l’étonnement de tous. Elle apparaît elle aussi vêtue en motard noir, elle aussi à la recherche des documents et du testament. On comprend alors que la vidéo initiale était une métaphore de son parcours de sa course, qui va devenir l’espace de l’opéra une course à l’abîme.
Et dans toute la deuxième partie (les deux derniers actes) Emilia évolue dans cet appartement aux lignes géométriques glaciales et sans âme qui va devenir l'espace glacé d'une contradiction, d’un côté des personnages qui pourraient être des personnages de théâtre bourgeois, qui s’agitent autour de la Diva, c’est l’image qu’on en a dans la mise en scène de Tcherniakov à Zurich ou de théâtre assez proche de la revue hollywoodienne comme chez Warlikowski, de l'autre un mythe qui va se démythifier au cours de l’histoire.
Mundruczó crée en effet un hiatus, la femme que tous adorent va peu à peu se défaire, de « zombifier » comme une momie dont on déferait les bandelettes, qui perdrait peu à peu sa substance. Déjà elle apparaît différente après avoir laissé son uniforme de motard, elle ne va cesser de changer d'apparence (les perruques), et de vêtement pour finir en corps d’adolescente qui a trop grandi, sans aucune once d’érotisme capable d’exciter les hommes qui tournent autour d’elles, chauve, comme si elle était malade, en phase terminale.
C’est la singularité de ce personnage que Mundruczó souligne dans sa mise en scène, qui oscille entre réalisme « bourgeois » et science-fiction, fumées, éclairages violents qui font rupture avec une trame où le livret joue ordinairement sur la normalité et le « léger » décalage qui crée le fantastique constitué par Emilia Marty.
La puissance de séduction de la femme qui était un des points forts du livret (et qui donnait au personnage une allure de star) est ici ailleurs : c’est la « singularité » de cette femme, son altérité, située entre vie, survie et mort, qui fait sa puissance.
Alors, autour de sa fin, une vision onirique de tous les meubles qui s’envolent, suspendus, pendant qu’Emilia va s’enfoncer dans le sol, non sans avoir vécu une sorte de transfiguration au moment où elle a énoncé la vérité sur sa (ses) vies.
Au réalisme apparent de la trame, Mundruczó souligne l’irrationnel grâce aux éclairages, très bien faits de Felice Ross, et à des artifices de théâtre : au total, un travail singulier qui s’appuie aussi sur la personnalité scénique de Rachel Harnisch, au format plus frêle que d’autres artistes ayant interprété le rôle car dans cette mise en scène, impossible d’imaginer une Mattila par exemple, ni même une Herlitzius.
Alors que les Emilia Marty habituelles « se posent là », même dans la mort, l’Emilia Marty de Mundruczó se désagrège peu à peu jusqu’au lambeau. C’est là l’originalité de ce travail qui marginalise d’entrée l’héroïne, en aveuglant les autres personnages, même les plus émouvants (Hauk-Šendorf voire Prus lorsqu'il apprend le suicide de son fils). En singularisant à ce point son héroïne, Mundruczó détruit aussi l’effet « thriller », rendant l’intrigue secondaire : l’enjeu est ailleurs.
La situation sanitaire a contraint le Grand Théâtre à éviter la présence en fosse de l’OSR, car l’orchestre de Janáček est plutôt fourni. En juillet dernier, Tomáš Netopil a enregistré la partie orchestrale et c’est cet enregistrement qui est utilisé. Ce n’est donc pas la solution zurichoise, où l’orchestre était en direct à distance. En revanche, le chef peut donner en dirigeant des indications à l’ingénieur du son pour moduler l’enregistrement selon les éléments qu’il veut valoriser et le volume par rapport aux voix : son rôle en fosse n’est donc pas seulement de diriger les chanteurs, mais aussi diriger le son.
Au départ, on est gêné parce que le son enregistré aplatit la rutilance si particulière de la partition de Janáček et l’enregistrement apparaît sans relief, sans profondeur, à deux dimensions. Il est clair que l’on ne peut prétendre à un rendu équivalent à la musique vivante (et heureusement…), mais dès que les chanteurs interviennent, on oublie cette gêne et le système subterfuge fonctionne. Et on peut dire que Netopil tient cet ensemble virtuel-présentiel (pour employer le détestable vocabulaire ambiant) avec l’attention voulue : on connaît depuis longtemps les qualités de ce chef notamment dans Janáček depuis les lointaines Katia Kabanova parisiennes de 2011. Il reste que voir ce chef diriger partiellement « à vide », même s’il a dirigé l’orchestre pour l’enregistrement fait une singulière impression, même s’il faut saluer la performance.
Du côté des chanteurs, la distribution pour les rôles principaux est semblable à celle de l’Opéra des Flandres, ce qui garantit une fidélité à la mise en scène et un esprit de plateau plus cohérent, mis c’est l’ensemble du plateau, y compris les nouveaux venus et notamment les membres du « Jeune Ensemble » qui est à la hauteur de l’enjeu. La difficulté de l’œuvre consiste à ce côté « conversation en musique » qui demande aux chanteurs à la fois la fluidité, l’expression, le naturel du théâtre, et néanmoins la voix chantée et colorée nécessaire. Aucun maillon faible dans une distribution remarquable.
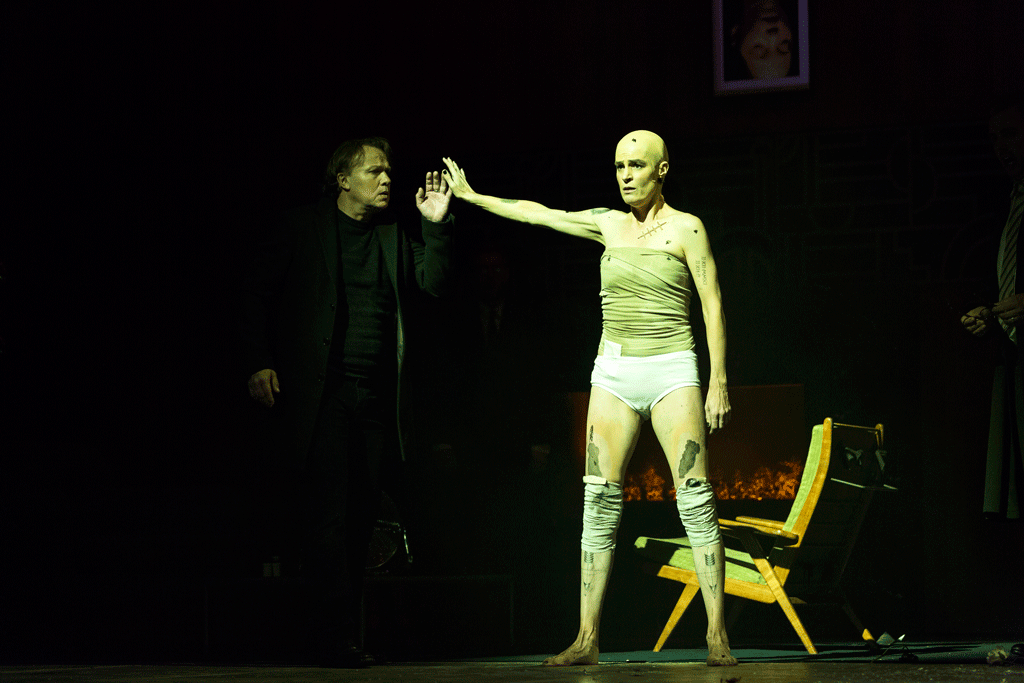
Aleš Briscein est Albert Gregor, l’un des meilleurs ténors actuels de la république Tchèque (avec Pavel Černoch) qui chante évidemment très souvent Janáček, la voix est sonore et puissante, le timbre assez lumineux, il est toujours très expressif et bon acteur.

Excellent aussi, notamment par le phrasé et surtout très expressif le baryton-basse hongrois Karóly Szemerédy dans le rôle de l’avocat Kolenatý. Nous avions déjà remarqué Sam Furness à Zurich où il incarnait Albert Gregor. Il est ici Vitek, avec les mêmes qualités d’expression et de présence scénique, voilà un ténor à suivre assurément. Michael Kraus est impérial dans Jaroslav Prus ; le baryton viennois qui depuis septembre dirige l’Opéra-Studio du Wiener Staatsoper est ici non seulement prodigieusement expressif, mais montre aussi une belle présence qui fait donne à Prus du mordant et un véritable relief.
Il faut enfin saluer les trois membres du jeune ensemble, Julien Henric (Janek Prus) et surtout la Krista de Anna Schaumlöffel, vive, fraiche, avec une voix claire, acérée, vigoureuse, et Ludovit Ludha en Hauk-Šendorf, le seul personnage « de caractère », très juste dans cette figure à la fois bouffe, passionnée et dérisoire.
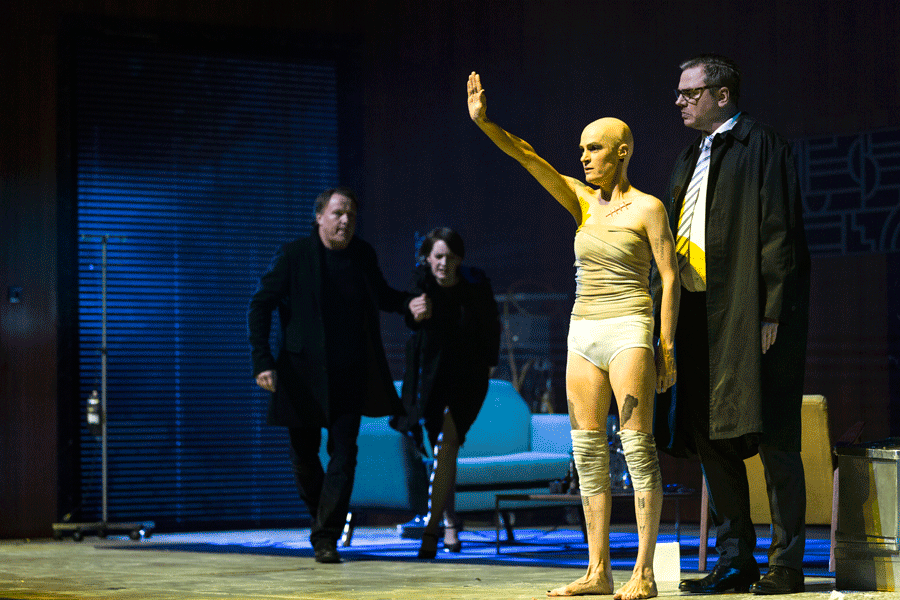
Mais tout ce petit monde est là pour tourner autour d’Emilia Marty, qui est Rachel Harnisch, une chanteuse qu’on connaît depuis longtemps, qui a souvent chanté avec Abbado, notamment Schubert et Mozart. Elle nous avait beaucoup plu dans La Juive à Lyon où nous avions loué son chant très habité. Elle est ici, comme à Gand, ce personnage engagé, incarné qui la rend à la fois impressionnante et bouleversante. Physiquement, elle ne cesse de se transformer, du motard initial, changeant de vêtements et peu à peu s’en débarrassant, effeuillée jusqu’à l’essentiel, comme si au fur et à mesure qu’on avançait dans l’œuvre elle ouvrait au monde sa vraie nature, son vrai corps si admiré et qui pourtant semble à la fin décharné et repoussant. Comme si cet « effeuillage » était effeuillage de l’âme jusqu’au noyau le plus profond et jusqu’au vrai. Une performance exceptionnelle, avec un sens du dire, une modulation des couleurs, de l’humour au sarcasme et à la déchirure, qui en fait une des très grandes Emilia Marty, à l’égal des plus grandes et sur un autre mode, à la fois plus humain et plus « ailleurs » : elle affiche son côté divers et polymorphe, dans l’aspect comme dans la voix au son très différencié selon les registres. Supérieur.
On comprend du même coup l’immense frustration que ce spectacle d’une grande solidité et magnifiquement distribué n’ait pu aller à Genève jusqu’à son terme. Dans un monde post-Covid, qui finira bien par arriver, il mérite une reprise, avec orchestre en fosse et les mêmes protagonistes, une salle pleine et évidemment un triomphe .
Trailer :
