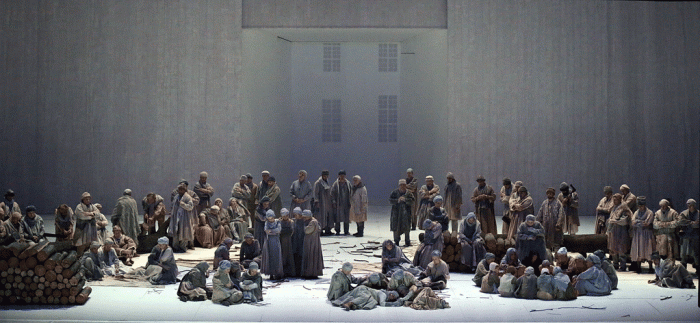Peter Stein est une gloire de la scène, un de ces metteurs en scènes historiques qui ont contribué à révolutionner la scène théâtrale et lyrique des cinquante dernières années. Il a depuis plusieurs années renoncé à travailler la dramaturgie, préférant une approche plus illustrative. Ce Don Carlo importé de Salzbourg est le dernier avatar de travaux où on lit quelquefois la patte d’un maître, notamment dans les mouvements de foule, et quelquefois dans la disposition des personnages, mais qui pêche par quelques problèmes :
Peter Stein est une gloire de la scène, un de ces metteurs en scènes historiques qui ont contribué à révolutionner la scène théâtrale et lyrique des cinquante dernières années. Il a depuis plusieurs années renoncé à travailler la dramaturgie, préférant une approche plus illustrative. Ce Don Carlo importé de Salzbourg est le dernier avatar de travaux où on lit quelquefois la patte d’un maître, notamment dans les mouvements de foule, et quelquefois dans la disposition des personnages, mais qui pêche par quelques problèmes :
- Le plateau de Salzbourg plus large que haut passe difficilement de l’horizontal au vertical de la Scala (on l’avait aussi vu de manière moins sensible avec Die Soldaten d’Hermanis) et la scène de l’autodafé en souffre, mais aussi un certain spectaculaire, nécessaire pour le genre.
- On ne démêle aucune intention dans ce travail superficiel, illustratif, dans des décors stylisés de Ferdinand Wögerbauer concentrant le regard sur une action qui a peine à s’imposer : la longueur de l’œuvre exige pour maintenir l’attention une vraie direction scénique, et ici, ce sont les chanteurs qui décident des gestes et des attitudes pour une intrigue qui ne se déroule trop souvent au premier plan. Quand c’est Furlanetto, c’est parfait. Quand c’est Stoyanova, ça l’est moins.
- Le fait d’habiller de noir la cour d’Espagne en contraste avec celle de France ne peut faire office d’idée (costumes d’Anna Maria Heinrich), car on l'a vu bien des fois, sauf à apprécier les ondulations des compagnes d’Eboli, qui esquissent des mouvements de danse en laissant voir quelques couleurs dans leurs dessous ou leurs coiffures, une ironie qu’on retrouve çà et là, notamment dans les costumes venus des colonies, indiens d’Amérique, Incas etc… dans la scène de l’autodafé, montrant la christianisation de peuples qui ne la demandaient pas. Quelques pointes acérées du regard de Stein, mais rien de continu.
- Il n’y aucune poésie dans ce travail, aucun élément évocatoire, aucune accroche et je dirai peu de sensibilité, comme si Stein restait extérieur à une œuvre qui malgré tout ce qu’on a écrit sur elle, est brûlante, ambiguë (la relation de Posa à Carlo), profondément humaine.
Avec tout le respect dû à Peter Stein qui reste un grand professionnel, ce travail ne correspond par son résultat ni à sa réputation, ni à l’œuvre, ni au lieu. Car même pour un public aussi conservateur que celui de la Scala, on eût pu attendre un minimum d’effort pour rendre quelque chose d’autre qu’un défilé de poncifs et de gestes convenus. On frémit en pensant quelles sommes ont pu débourser les spectateurs de Salzbourg pour voir une production aussi médiocre, même s’il est vrai qu’avec Jonas Kaufmann et Anja Harteros dans la distribution, ils avaient d’autres chats à fouetter.
Néanmoins je vois là une dérive dangereuse de la politique artistique de la Scala : voilà un théâtre dont l’image est étroitement liée au répertoire italien et notamment à Verdi, voilà une œuvre mal aimée dont on présente (et c’est bienvenu) une version inconnue du public, dans une distribution de qualité : autant de raisons pour justifier une production en propre et non une production venue d’ailleurs. Ce qu’on peut comprendre pour des œuvres d’un répertoire étranger à l’univers scaligère se comprend mal pour le cœur de cible du théâtre.
Mais du moins, musicalement, les choses étaient fort différentes.
Tout d’abord on ne peut que saluer l’affichage de trois chanteurs italiens dans un Verdi à la Scala, c’est un signe d’espoir : la situation difficile du chant italien est aussi cause de la difficulté qu’avait depuis longtemps la Scala à défendre dignement son image et son répertoire.
Ferruccio Furlanetto depuis bientôt quarante ans affiche un Filippo II qui fut et reste une pierre miliaire, le succès le plus important de la soirée pour le rôle le mieux défendu. C’est dans la scène avec Posa au deuxième acte, celle qui selon les termes-même de Verdi, lui a fait littéralement « cracher les poumons » , qu’il est le plus spectaculaire, non tant par la voix (Furlanetto n’a jamais été un Ghiaurov), mais pour le phrasé, pour la couleur, pour le poids des mots, insurpassable maîtrise du rôle, et avantage éminent d’être italien, pour le naturel de certains accents et l’agilité du ton. Bien sûr, Ella giammai m’amo’ fait aussi son effet, avec une science consommée des couleurs, plus dans le retour à soi, dans l’interrogation angoissée ou déçue, dans le théâtre au sens noble que l’artiste investit. Plus qu’une interprétation, c’est une incarnation.
 Francesco Meli était Don Carlo, un rôle où son timbre (moins solaire qu’il y a quelques années, mais toujours magnifique de pureté) fait merveille, et où sa science éminente du phrasé, sa diction d’une incroyable clarté stupéfient. Mais pour sa prise de rôle, il manque à ce chanteur magnifique un peu de charisme en scène (il est vrai que Stein n’y aide pas) et surtout la maîtrise des aigus où l’on constate toujours un resserrement de la voix, mal projetée et une certaine tension : c’est évident à l’acte III, dans la scène de l’autodafé, dont le "si" est plutôt savonné (sarò tuo salvator, popol fiammingo, io sol !) et qui fut aussi fatal à Luciano Pavarotti sur cette même scène. Il reste néanmoins un très beau Don Carlo qu'il rôdera et qui murira.
Francesco Meli était Don Carlo, un rôle où son timbre (moins solaire qu’il y a quelques années, mais toujours magnifique de pureté) fait merveille, et où sa science éminente du phrasé, sa diction d’une incroyable clarté stupéfient. Mais pour sa prise de rôle, il manque à ce chanteur magnifique un peu de charisme en scène (il est vrai que Stein n’y aide pas) et surtout la maîtrise des aigus où l’on constate toujours un resserrement de la voix, mal projetée et une certaine tension : c’est évident à l’acte III, dans la scène de l’autodafé, dont le "si" est plutôt savonné (sarò tuo salvator, popol fiammingo, io sol !) et qui fut aussi fatal à Luciano Pavarotti sur cette même scène. Il reste néanmoins un très beau Don Carlo qu'il rôdera et qui murira.
Le Posa du jeune baryton Simone Piazzola, à peine trente ans, malgré un timbre un peu opaque (pas trop gênant dans Posa), malgré une voix pas toujours bien projetée, au volume limité, a réussi à être toujours convaincant et émouvant, et surtout à toujours être juste. Évidemment, dans O Carlo ascolta au quatrième acte, il réussit à être vrai, parce que les limites vocales deviennent ici des qualités dont il joue. Malgré les réserves c’est une prestation qui montre qu’avec des moyens pas forcément adéquats, mais avec intelligence et sensibilité, on peut remporter un beau succès justifié.
Eric Halfvarson remplaçait Orlin Anastassov dans le Grand Inquisiteur, la voix est fatiguée (il était déjà le Grand Inquisiteur en 1995 au Châtelet avec Pappano), manque du legato nécessaire, mais grâce à certains accents et une longue fréquentation du rôle, la prestation reste honorable tandis que Martin Summer dans le moine, de l’Accademia di perfezionamento del Teatro alla Scala, montre qu’il a de l’avenir…
Du côté féminin, Krassimira Stoyanova démontre comme souvent quelle styliste elle est, avec une élégance et une très grande sûreté, même si Elisabetta n’est pas forcément le rôle qui lui sied le mieux vocalement : la voix manque un peu de volume dans un rôle qui en exige. Ce qui frappe chez elle, c’est le souci du détail, c’est la propreté du rendu, c’est la perfection formelle sans bavure, d'une netteté cristalline. Il manque pourtant à cette voix une personnalité. Elisabetta est de braise, de ces braises couvertes par un manteau apparent de gel. Il n’y a pas toujours le frémissement voulu dans cette prestation plus impeccable qu’habitée.
Enfin l’Eboli d’Ekaterina Semenchuk n’a rien d’une Eboli, le volume est relativement limité, l’incarnation et la personnalité vocale peu convaincantes, les notes sont faites, mais sans être à aucun moment vocalement le personnage et sans vraie grâce (indispensable pour cette séductrice) sur scène. Il n’y a pas de vraie faute de chant, mais tout cela reste plat, un peu maniéré, et manque et d’élégance et de furore. Ce qu’il faudrait dans Eboli, c’est une voix à la Herlitzius, mais italienne qui sache darder les aigus de O don fatale tout en vocalisant et en trillant aimablement la canzone del velo (la Saracena) . Ce modèle-là n’existe pas sur le marché aujourd’hui. Mais en l’absence d’oiseau rare, dans les voix slaves, Smirnova eût sans doute mieux fait…
Passons sur le Tebaldo acide de Theresa Zisser, et saluons le beau chœur des députés flamands, tous des jeunes valeureux en académie ou au conservatoire, tout comme le Lerma de Azer Zada.
Le chœur de la Scala reste l’un des grands chœurs d’opéra, mais outre quelques problèmes de décalage dans la belle scène initiale qui est l’un des joyaux de la version originale, la scène I de l’acte trois, dans un décor ridicule qui ne dit rien du mystère de la nuit festive (du genre comme certains ont dit "les couloirs de sécurité des aéroports") laisse totalement froid, et la scène de l’autodafé n’est pas aussi convaincante qu’il y a quelques années.
C’est Myung-Whun Chung, dont on connaît le goût pour le répertoire italien, qui organise tout ce beau monde. D’abord, sa direction est fort soucieuse du plateau, très attentive à ne jamais le couvrir. Ce souci du chanteur est vraiment permanent, et la maîtrise du volume de l’orchestre réelle dans une œuvre où l’on peut quelquefois exagérer…
Le tempo est relativement retenu, et permet aussi d’exalter certains moments de la partition (là aussi, les premières mesures sont particulièrement intéressantes pour comprendre son épaisseur). Ce qui frappe, c’est un certain équilibre général, qui donne une couleur assez retenue et sombre à l’ensemble notamment dans les moments plus lyriques et plus intimistes. C’est cependant dans la dernière partie, surtout au cinquième acte que l’orchestre fait entendre quelques sortilèges sonores, comme la magnifique introduction à Tu che le vanità, charnue et vibrante, qui montre une direction sensible rendant vraiment justice à l’œuvre. Ce qui est intéressant dans son travail, c’est le souci de ne jamais « briller » gratuitement – ce qui serait facile dans un genre comme le Grand Opéra, mais d’accompagner le drame, avec la tension voulue, et avec le souci de clarté qui permet d’entendre vraiment la complexité de l’œuvre tout en restant mesuré. Il remporte un vrai succès, très justifié.
Une seule conclusion : depuis la fameuse production Ronconi/Abbado de 1977, réussie et mythique désormais, Don Carlo n’a pas de chance à la Scala. Il faudra donc encore attendre pour une production qui corresponde à ce théâtre dans tous ses aspects. Cela confirme que l’œuvre est l’une des plus difficiles à monter qui soient.